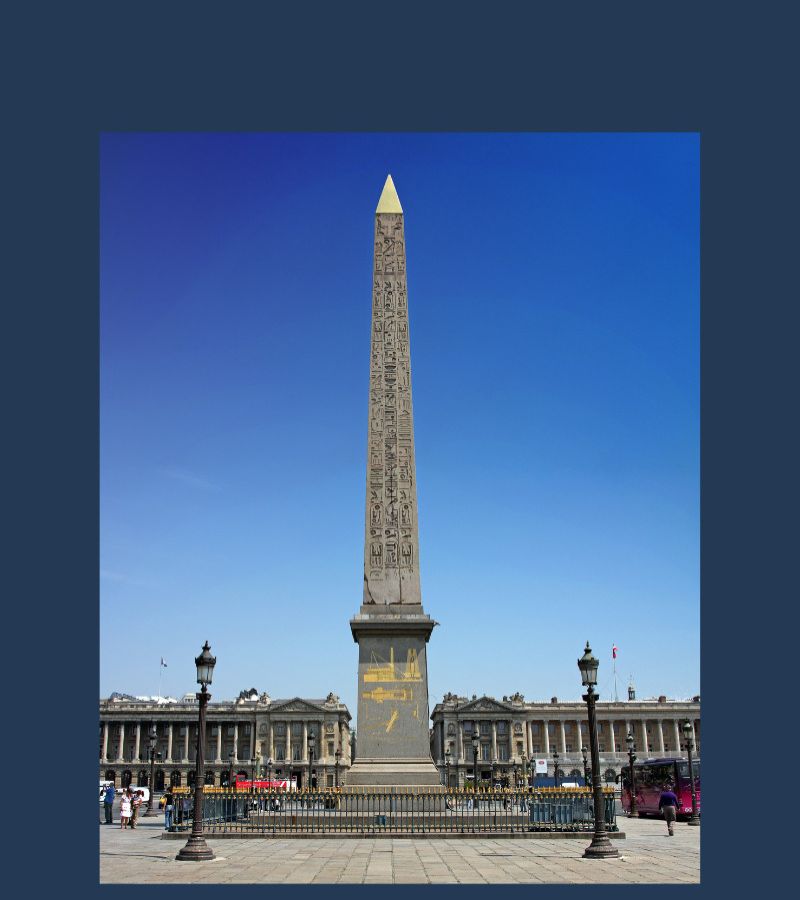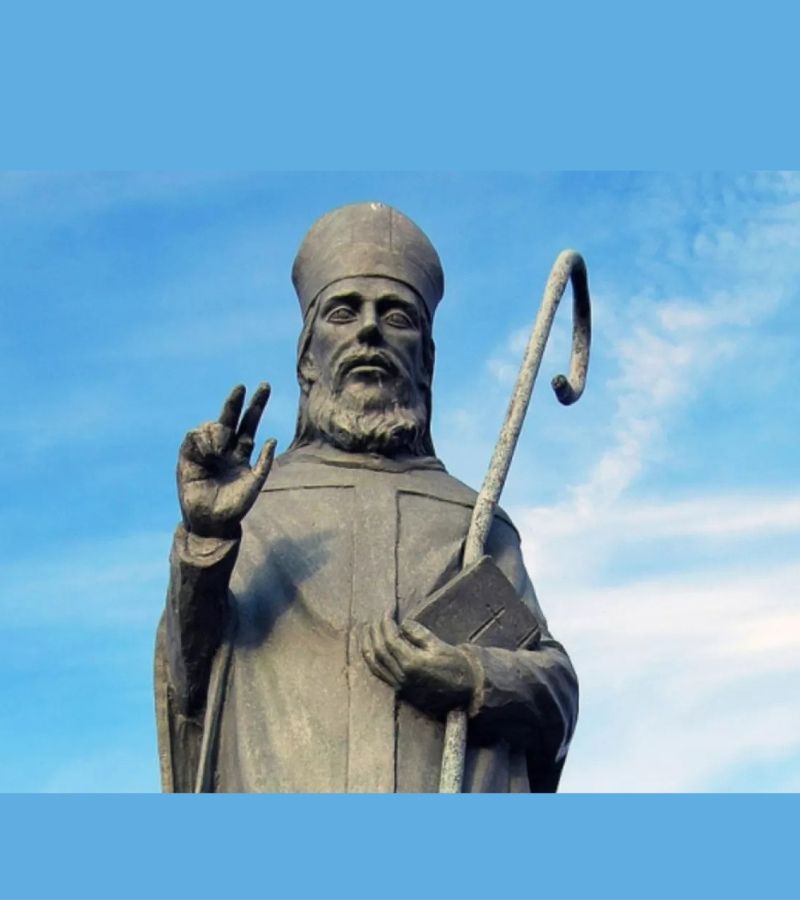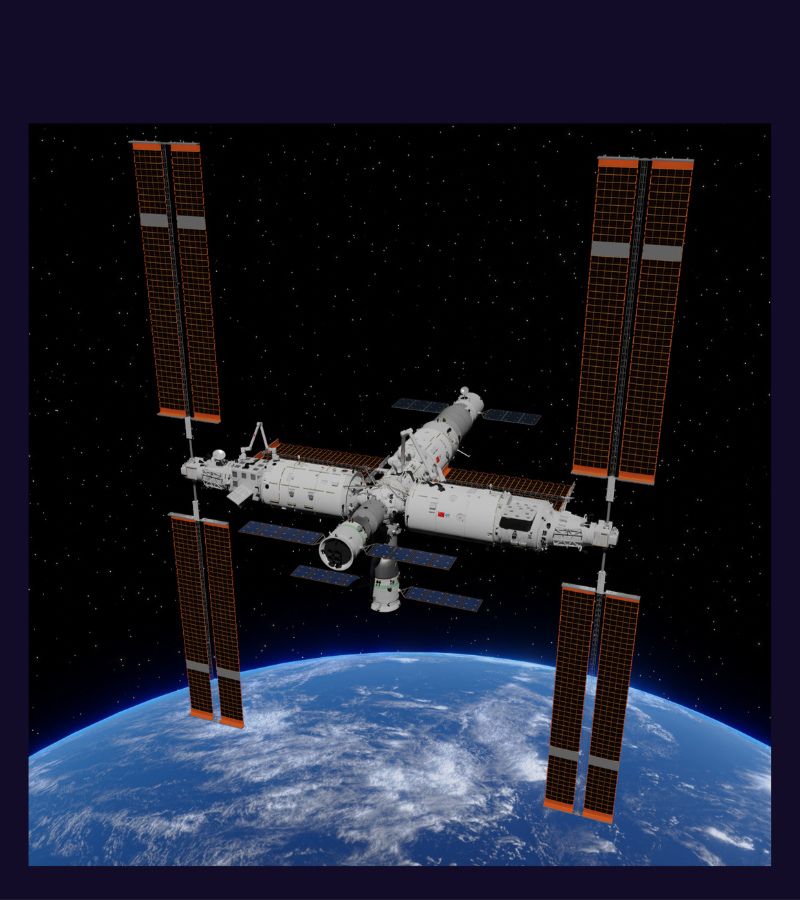2 novembre 2020 – Avant les années 1960, il s’agissait du quatrième plus grand lac au monde, situé entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Il couvrait plus de 66 000 km2. Appelé « mer d’Aral », ce lac aujourd’hui asséché à 90% doit sa désastreuse transformation à l’Homme.
En effet, cette modification terrestre cache les conséquences d’une course agro-commerciale entamée au début de la guerre froide.
À cette époque, le gouvernement soviétique, qui contrôle plusieurs pays d’Asie centrale, décide de transformer les vastes steppes désertiques de la région en plantations intensives de blé et de coton. De grands travaux sont alors lancés et les deux grands fleuves locaux, le Syr-Darya et l’Amu-Darya, sont détournés et de nombreux canaux d’irrigation sont creusés. Les cultures se multiplient. En 1988, l’Ouzbékistan devient l’un des plus gros exportateurs de coton de la planète. Mais pendant que les moissonneuses tournent à plein régime, la mer d’Aral, privée de ses principaux affluents, s’assèche.
Un bras de terre apparaît alors entre sa partie nord et sud, la divisant en deux. Cette évaporation fait exploser la salinité du lac, tandis que les pesticides et engrais utilisés en masse dans les champs viennent s’y déposer. Cette combinaison destructrice extermine les poissons, dont vingt espèces endémiques, à jamais rayées de la surface du globe.
DES CONSÉQUENCES SANITAIRES ET ÉCOLOGIQUES GRAVES
Autour du lac asséché, une grande partie de la population, dont 40 000 pêcheurs, a fini par s’exiler. Aujourd’hui, les bateaux rouillés posés sur le sol sont le seul témoignage du passé.
Saturé en sel, le sol est devenu infertile et les vents balayent une poussière rendue toxique par des années d’exploitation industrielle. Parmi les habitants qui sont restés, on dénombre des taux anormaux de cancers, de maladies pulmonaires et d’anémies. Le taux de mortalité infantile figure également parmi les plus élevés au monde.
Face à cette crise d’ampleur, l’État Kazakh, indépendant depuis la chute de l’URSS en 1991, a décidé d’agir. Avec l’aide de la Banque mondiale, il inaugure en 2005 le barrage de Kokaral. Le barrage couplé à plusieurs mesures environnementales, telles que la réintroduction d’une quinzaine d’espèce de poissons, a permis de faire revivre la partie nord de la mer d’Aral.
En revanche, du côté sud, l’Ouzbékistan ne montre pas la même motivation. Sixième plus gros producteur de coton au monde, le pays puise encore dans les ressources en eau pour irriguer les cultures.
Selon Alice Aureli, spécialiste en hydrologie et climat à l’UNESCO, le pays n’est pas le seul responsable : « C’est un problème de coordination et de coopération pour organiser la gestion de l’eau de la région » ; « Sans une bonne gestion et une bonne politique concernant les ressources en eau, particulièrement concernant la protection des glaciers menacés par le réchauffement climatique, malheureusement, il n’y aura pas d’avenir pour la mer d’Aral dans le siècle à venir ».
UN SITE CIBLÉ AUPARAVANT
En 1948, un laboratoire d’armes biologiques top secret avait été établi sur l’île de Vozrojdénia située au centre de la mer d’Aral, devenue une péninsule partagée entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. À ce jour, l’histoire exacte et les fonctions de ce centre n’ont pas encore été divulguées. La base a été abandonnée à la suite de la désintégration de l’URSS. Les expéditions scientifiques ont prouvé que cela avait été un site de production, d’essai et de fabrication d’armes pathogènes. En 2002, à travers un projet organisé par les États-Unis et avec l’assistance de l’Ouzbékistan, 10 sites d’enfouissements d’anthrax y ont été décontaminés. L’anthrax était une arme bactériologique lors de la Première Guerre mondiale dont la dispersion de spores dans l’air ambiant entraînait une maladie infectieuse « la maladie du charbon » qui touchait les voies respiratoires.
Un lieu naturel sacrifié parmi tant d’autres !
Carine Privard (rédaction btlv.fr)